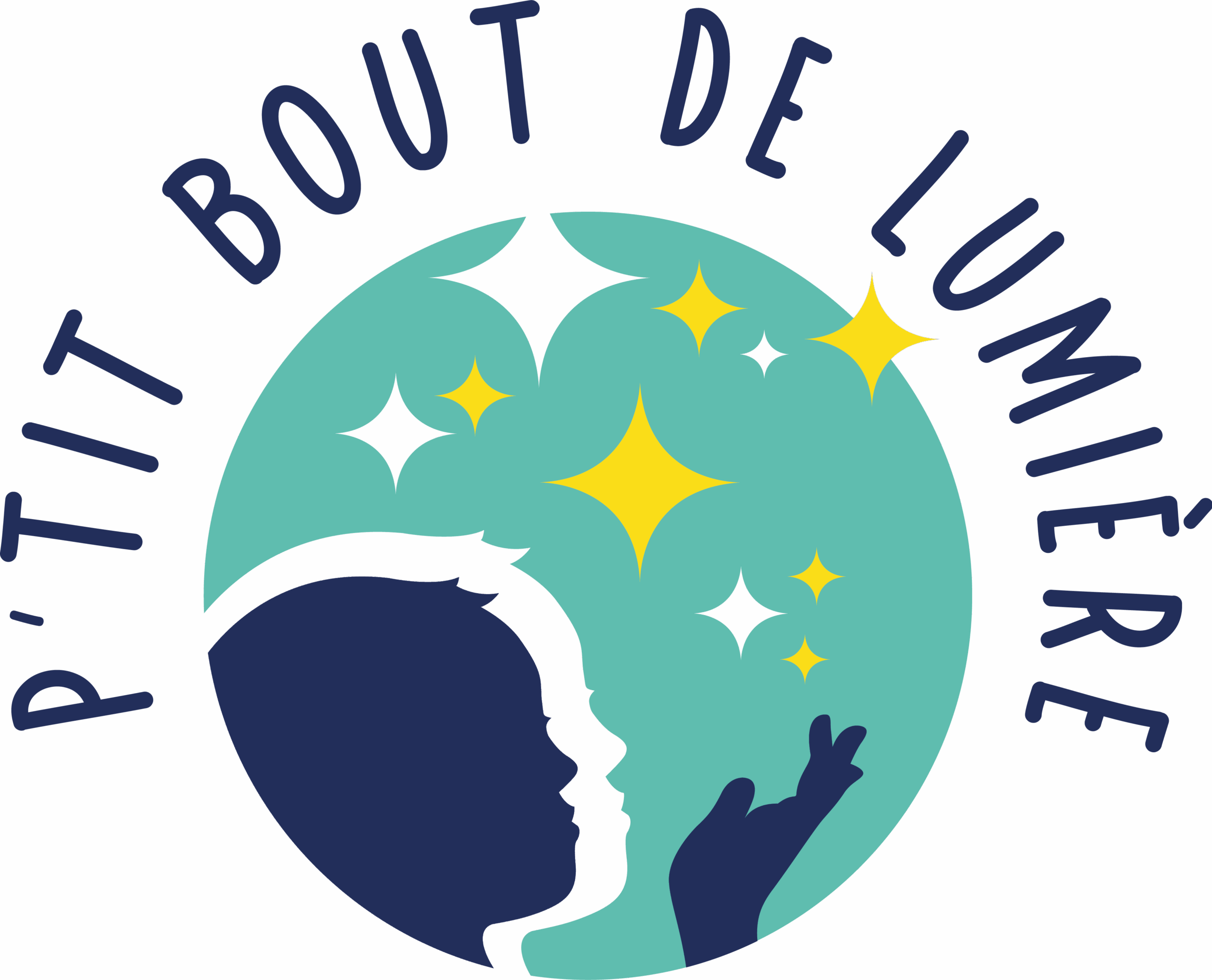Le jeu lors des soins : réduire douleur et anxiété
Et si le jeu n’était pas seulement une source de plaisir, mais aussi un moyen de se sentir mieux, de soulager la douleur et d’apaiser son esprit ?
Lors d’un soin médical, surtout lorsqu’il génère du stress ou de la peur, le corps et le cerveau réagissent fortement. Le rythme cardiaque s’accélère, les muscles se contractent, l’attention se fige sur l’inconfort.
Dans ces moments-là, le jeu devient un véritable allié thérapeutique : il détourne l’attention, apaise les émotions et transforme l’expérience du soin en moment de respiration et de réassurance.
Le jeu : un mécanisme naturel qui apaise le corps et l’esprit
Le jeu déclenche dans le cerveau des réactions biologiques profondément bénéfiques.
Selon l’UNICEF, jouer stimule la sécrétion d’hormones du bien-être comme les endorphines (antidouleurs naturels) et la dopamine (hormone du plaisir et de la motivation). Ces molécules créent un sentiment d’apaisement et réduisent la perception de la douleur.
Dans le même temps, le corps produit moins de cortisol, l’hormone liée au stress.
Une étude menée par la Faculté de Médecine de Clermont Auvergne détaille ce phénomène. Concrètement, il active le cortex préfrontal, qui gère la planification et le contrôle émotionnel, tout en diminuant l’activité de l’amygdale, le centre de la peur et de l’alerte.
Ce double effet crée un cercle vertueux :
• le cerveau se concentre sur une activité positive,
• les émotions négatives s’atténuent,
• la douleur est toujours présente, mais perçue avec moins d’intensité.
Sur le plan psychologique, le jeu rétablit un sentiment de sécurité et de maîtrise. Il offre une échappatoire mentale, un espace où l’enfant (ou l’adulte) peut redevenir acteur de ses émotions et retrouver un équilibre intérieur.
Autrement dit : jouer, c’est déjà se soigner un peu.

Le jeu lors des soins : une approche de plus en plus reconnue
Les recherches de l’Inserm confirment que la douleur et l’anxiété ne sont pas uniquement physiques.
Elles dépendent aussi de notre état émotionnel, de nos pensées et du contexte du soin.
Ainsi, deux personnes peuvent ressentir une douleur identique sur le plan médical, mais vivre une expérience totalement différente selon leur niveau de stress ou de confiance.
C’est pourquoi de nombreux professionnels de santé (pédiatres, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes…) intègrent désormais le jeu comme outil thérapeutique complémentaire.
Le jeu agit en redirigeant l’attention et en apaisant l’esprit. Il contribue ainsi à réguler les facteurs psychologiques qui amplifient la douleur, comme la peur, l’anticipation négative ou l’hypervigilance.
En engageant le cerveau dans une dynamique positive, il modifie les circuits neuronaux impliqués dans la perception de la douleur. Lorsque le cerveau se sent en sécurité, le corps se détend naturellement, ce qui rend l’expérience du soin plus confortable.
Selon une étude publiée sur EM consulte , le jeu transforme le rapport au soin : au lieu d’être un acte subi, il devient une expérience partagée.
Le patient, en jouant, retrouve un rôle actif, interagit et collabore plus facilement.
Cette participation active favorise la confiance, la coopération et l’acceptation du traitement.
Enfin, le jeu est universel. Il n’a pas d’âge, ni de niveau.
Chez les enfants, il soutient la symbolisation et l’expression émotionnelle.
Chez les adultes, il réactive la créativité et la capacité d’imagination.
C’est un langage commun qui relie corps, esprit et relation humaine.

Les différents types de jeux et leur impact sur l’anxiété et la douleur
Tous les jeux ne produisent pas les mêmes effets, mais chacun possède une utilité spécifique selon les besoins et le moment du soin.
- LES JEUX DE CONCENTRATION
Ils mobilisent fortement l’attention.
En se focalisant sur une tâche volontaire (un puzzle, un défi visuel ou une activité manuelle) le cerveau réduit la place disponible pour la douleur.
Ce mécanisme est appelé distraction cognitive : il aide à relativiser la sensation physique.
- LES JEUX SENSORIELS
Ils stimulent les sens (vue, son, toucher, mouvement).
Musique douce, bulles de savon, veilleuse, manipulation d’objets texturés…
Ces activités favorisent la relaxation corporelle, relâchent les tensions musculaires et diminuent les manifestations physiques de l’anxiété (tremblements, respiration rapide…).
- LES JEUX NARRATIFS ET SYMBOLIQUES
Ils permettent d’imaginer, de se raconter une histoire ou de personnifier sa peur.
Un enfant qui “soigne” sa peluche avant son vaccin, par exemple, reprend symboliquement le contrôle.
Ce type de jeu favorise la confiance, la compréhension du soin et la réduction du stress anticipatoire.
- LES EXPÉRIENCES IMMERSIVES ET MULTISENSORIELLES
Avec les nouvelles technologies, les jeux deviennent de véritables environnements sensoriels.
Ils plongent le joueur dans un univers qui mobilise tous ses sens, encourage la respiration consciente et installe une concentration apaisée.
En engageant pleinement le corps et l’esprit, ces expériences favorisent un état de présence et de détente profonde, tout en stimulant l’attention et la motivation. Ces outils offrent un cadre rassurant qui combine détente mentale et engagement actif, particulièrement utile pour accompagner des soins longs ou invasifs.
(Pour en savoir plus sur les jeux immersifs et leurs applications en cabinet, découvrez notre article sur l’intégration d’une solution numérique.)
La réalité virtuelle : UN NOUVEL HORIZON DU JEU THÉRAPEUTIQUE
La réalité virtuelle (VR) s’impose aujourd’hui comme l’une des innovations les plus prometteuses dans la gestion de la douleur et de l’anxiété.
Selon une publication dans Frontiers du Dr Rahul Kashyap, cette technologie transforme la perception sensorielle et émotionnelle du soin, en réinventant la manière dont le cerveau réagit face à la douleur.
Le principe est simple : grâce à un casque immersif, la personne est plongée dans un univers apaisant ou stimulant — un paysage, une histoire, un jeu de respiration.
L’attention se détourne alors naturellement de la sensation douloureuse : le cerveau se focalise sur ce qu’il voit, entend et ressent.
Cette immersion déclenche un état de calme et d’harmonie.
Les effets physiologiques sont concrets :
• la respiration ralentit,
• les muscles se relâchent,
• le rythme cardiaque se stabilise,
• et l’anxiété diminue.
Certaines expériences de réalité virtuelle vont plus loin : elles guident la respiration, renforcent la sensation de sécurité et redonnent au patient une posture active face au soin.
Résultat : une meilleure adhésion thérapeutique, un engagement renforcé et un souvenir plus doux de l’expérience médicale.
Plus qu’une technologie, la réalité virtuelle devient un véritable outil de soin, fondé sur la science, la douceur et l’autonomie.
Elle montre que, même au cœur du soin, il est possible de créer des espaces de détente, d’imagination et de confiance.

En conclusion
Le jeu rappelle que le bien-être ne se limite pas aux médicaments ou aux protocoles, mais qu’il dépend aussi de notre manière de vivre chaque instant.
En activant nos ressources naturelles d’adaptation (attention, imagination, respiration) il offre un pont entre plaisir, détente et soin.
Qu’il s’agisse d’un jeu simple, d’un conte ou d’un univers immersif en réalité virtuelle, l’objectif reste le même :
aider chacun à retrouver son calme intérieur, sa confiance et son pouvoir d’agir, même au cœur du soin.
Téléchargez notre guide pratique pour mettre à profit les différents types de jeux selon vos besoins.